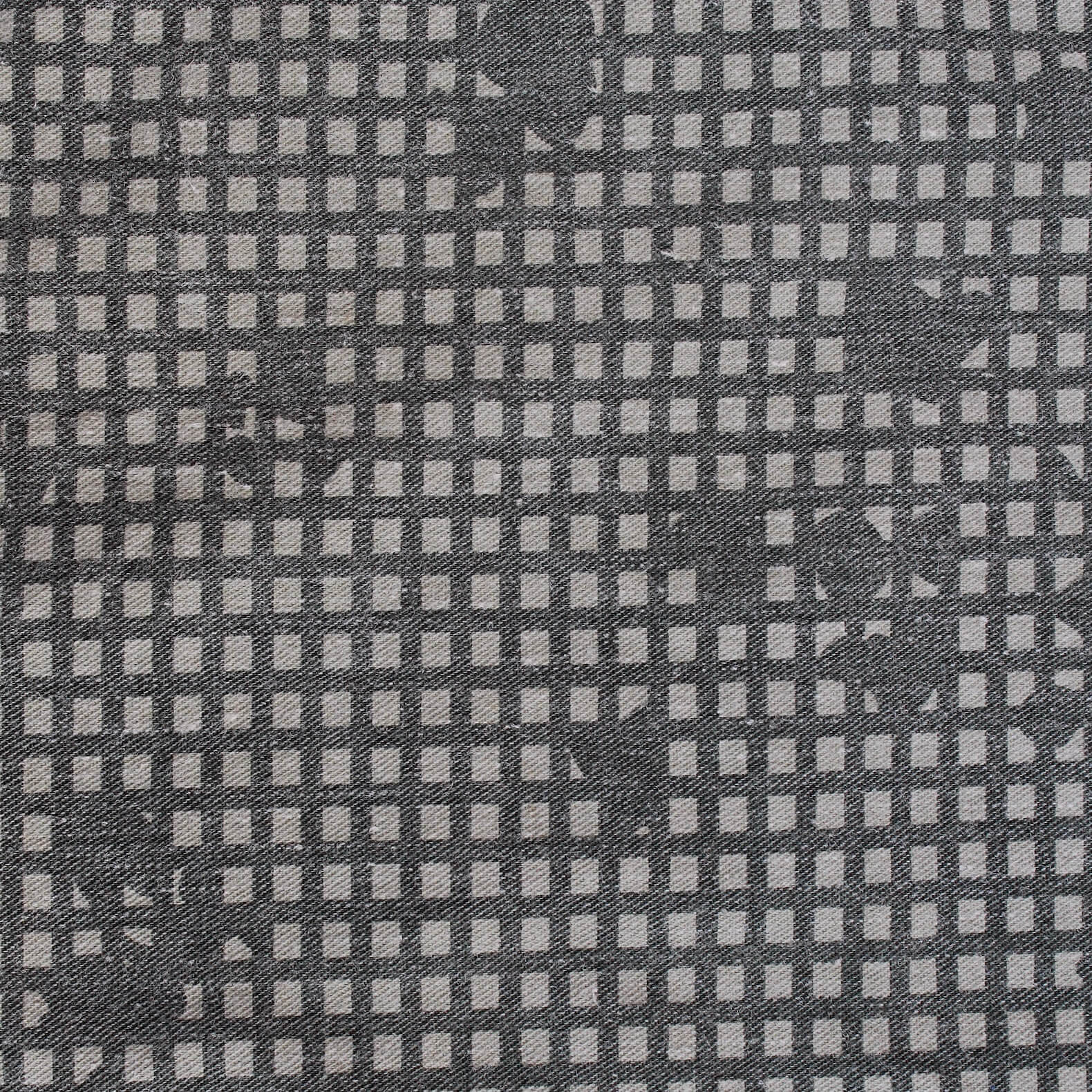Le gaspillage est au coeur de l’industrie textile. De la toute première étape de la production jusqu’a la consommation. Et nos fringues finissent bien souvent au même endroit que le reste des pates du midi, si elles n’ont pas eu la chance de se faire oublier au fond d’un tiroir. Enfin, ce ne sont peut-être pas exactement les nôtres qui connaissent un triste sort. Mais tout le monde n’a pas autant d’argent, de temps ou d’intérêt à consacrer à la question vestimentaire. Les beaux labels qui nous passionnent ne représentent pas grand chose à l’échelle du marché. L’achat moyen est de l’ordre du jetable, du chiffon en devenir. D’ailleurs, on parle sapes en additionnant les kilogrammes quand il est l’heure de faire le bilan. Des vêtements qui ne sont plus que piles, tas, balles. Des masses informes de tissus, de boutons et de fils dont plus personne ne veut.

tomokishida.com
Les choses changent, petit à petit. Une récente loi a interdit la destruction des invendus non-alimentaires en France. On observe une progression très nette du marché de la seconde-main. Des marques s’intéressent de plus en plus aux matières recyclées ou deadstock pour créer leurs nouvelles pièces. L’upcycling (réutiliser sans détruire au préalable), assidûment pratiqué chez Borali, gagne du terrain. Des fringues vintage sont recousues, rapiécées, brodées, réinterprétées. Certaines marques spécialisées dans le remake, comme Rifatto ou Kinott, subliment l’existant. Toutes ces initiatives se fondent sur une même idée : ne pas considérer que seul le neuf est désirable. La culture japonaise a fait de ce principe, l’aversion au gâchis, la philosophie du « Mottainai ». Lesashiko et lesakiori sont deux pratiques artisanales qui la concrétisent.
« Ne gaspille pas »
Il y a toujours dans l’histoire de l’artisanat textile traditionnel japonais l’évocation d’une idée de « nécessité ». La pauvreté, la famine, le manque expliquant naturellement le recours à la débrouille. Les paysans, pêcheurs et marchands du 18ème siècle qui, faute de moyens, réparent sans cesse un kimono, un hanten, une veste noragi, un sac de transport avec des matériaux de fortune. Les familles qui font leur propre papier à partir de fibres recyclées, le washi. Car on tissait principalement des fibres végétales (bast fibers) au Japon avant l’importation de la culture du coton de Chine et d’Inde au 16ème siècle. Le coton japonais n’était alors produit qu’en faibles quantités dans le sud du pays, peu adapté au rude climat du nord.
Les vêtements en coton, les seuls à même de protéger efficacement les travailleurs, étaient très précieux. Il était nécessaire de les réparer et de les user jusqu’a la corde pour espérer ne pas trop souffrir du froid.
Mottainai
Le concept de Mottainai , mot qui peut se traduire par « Ne gaspille pas » ou « Quel gâchis » et utilisé dès le 13ème siècle au japon, dépasse cependant la simple injonction de circonstance ou l’expression de l’instinct de survie en situation difficile. Il y a quelque chose de « l’essence japonaise » dans ce profond regret affiché face au gaspillage. Les raisons sont nombreuses et d’abord religieuses. L’animisme shintoïste. L’influence du bouddhisme. Cette idée d’harmonie entre l’homme et la nature, de valeur intrinsèque des choses qui nous sont offertes. Respecter un objet, le réparer, prolonger son existence… Ce ne sont pas seulement des réponses pragmatiques à des situations concrètes. Il s’agit aussi d’un mode de vie, de valeurs singulières.
Boro
Des valeurs spirituelles qui s’exportent à une époque où les questions environnementales n’ont jamais été aussi présentes. Aux cotés de « Mottainai », le mot « Boro » s’est imposé et désigne communément tous les textiles japonais raccommodés. Et plus particulièrement ces habits teints aux mille nuances d’indigo qui ont perdu forme et fonction. Aux armatures emmitouflées qui n’auraient jamais pu traverser les siècles si d’innombrables pièces de tissus de diverses origines (aux matières, couleurs, épaisseurs différentes…) n’avaient pas été laborieusement cousues entre elles au point sashiko. Formant des oeuvres en patchworks exprimant une beauté accidentelle, jamais consciemment planifiée. Boro n’était toutefois pas un mot utilisé ou même connu au japon. Et les pièces qui sont aujourd’hui muséifiées ou vendues à des sommes astronomiques à des collectionneurs n’avaient alors aucune valeur commerciale.
Le vrai luxe du tissage sakiori
L’avénement de la slow fashion, en réaction à une industrie qui cherche à toujours faire plus vite et moins cher, amène une frange minoritaire d’amateurs à reconsidérer les techniques artisanales du passé avec plus d’attention. On fait désormais le commerce d’objets qui témoignent d’un temps où le vêtement n’était pas un produit de consommation accessible à tous. Péniblement tissés, teints et cousus à la main deux cent ans plus tôt par nécessité, les haillons japonais boro indiquent un autre chemin à suivre. À une époque d’abondance, le vrai luxe est de produire peu et de le faire bien.

Le sakiori ( littéralement « déchirer » et « tisser ») est une pratique artisanale méconnue et quasiment disparue. Les marques et artisans qui proposent de nouvelles pièces sakiori, couteuses et délicates, sont rares. La pratique, qui consiste à utiliser ce qui est considéré comme inutilisable, correspond pourtant à une forme d’idéal éco-responsable tout à fait contemporain. Tissés pour la première fois au milieu du 18ème siècle dans le nord du japon, les vêtements sakiori se substituaient aux nouvelles pièces en coton. Le principe était de tisser une armure (weave) avec une chaîne (warp) en fibres libériennes (chanvre, ramie) ou coton et une trame (weft) en « chiffons ». C’est à dire en tissus déchirés provenant de kimono trop usés pour être réparés. Ou de vêtements déjà en tissus recyclés.



Le « devenir du chiffon » avec le projet Uni Iroikas Is
Le sakiori, au-delà de la curiosité historique et culturelle, est ainsi un art oublié qui nous oblige à changer de perspective. Jeter n’est plus une action quotidienne, banale. Car le déchet se fait matière première. Si les raisons qui nous amènent à ne pas gaspiller ont changées, les valeurs restent et s’incarnent d’une manière inédite à notre époque. Une nouvelle génération interroge les modes de production, la responsabilité même du créateur. Oliver Church à Paris favorise les vieux rouleaux de matières, le grain, la texture et les teintures naturelles. BODE à New York rend désirable le kitsch, de la nappe vintage au macramé. Et Tomo Koshida à Osaka, l’homme qui m’a donne envie d’écrire cet article en premier lieu, fait revivre le sakiori avec son projet Uni Iroikas Is.
Le documentaire passionnant « The mind of Sakiori » nous plonge dans son quotidien au sein de son petit atelier, du tissage de son fil à la main jusqu’à l’expression concrète des liens qui subsistent entre le créateur et ses oeuvres : Tomo répare, raccommode, reteint des pièces portées et aimées par ses clients, assurant la continuité d’un cercle vertueux.
Le mot de la fin
Si ce mouvement des marques de niche vers l’artisanat est louable, le sakiori n’est bien sûr pas une solution viable pour résoudre le problème du gaspillage. Et affirmer que les marques choisiraient cette pratique uniquement pour réduire les « déchets » (qui dans ce cas précis sont en réalité de très belles matières, mais utilisées autrement) serait malhonnête. L’idée est d’abord de faire du beau. Et c’est déjà pas mal.